Covid et École : l'épidémiologiste Dominique Costagliola a interpellé Jean-Michel Blanquer sur la gestion des risques sanitaires en milieu scolaire. Elle fait le point sur ce qu'on connaît aujourd'hui de la maladie.
 Grande spécialiste du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’épidémiologiste est rapidement appelée sur le front de la lutte contre le Covid-19 pour apporter son expertise. Elle a reçu le .
Grande spécialiste du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’épidémiologiste est rapidement appelée sur le front de la lutte contre le Covid-19 pour apporter son expertise. Elle a reçu le .
Vous vous êtes exprimée à plusieurs reprises, et vous avez interpellé le ministre sur l’ouverture des écoles en période de Covid. Quelles sont vos préconisations ?
Ce qui me choque – et c’est pour cela que j’ai pointé à plusieurs reprises l’action de M. Blanquer –, ce n’est pas qu’on laisse les écoles ouvertes, mais qu’on dise qu’il ne s’y passe rien en matière de transmission de la Covid-19. Parce que les décisions prises ne relèvent pas des seuls aspects sanitaires, il fallait travailler à trouver un équilibre entre les bénéfices et les risques.
Ce qui me choque […], ce n’est pas qu’on laisse les écoles ouvertes, mais qu’on dise qu’il ne s’y passe rien en matière de transmission de la Covid-19.
On connaît les moments critiques – comme le temps des repas, par exemple –, donc on pouvait décider d’installer des détecteurs de CO2 pour guider l’aération, ou des extracteurs là où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Mais cela a un coût ! À la place, on a une définition des cas contacts dans le protocole scolaire qui n’est pas celle adoptée pour toutes les autres situations. Pourquoi ? Scientifiquement, cela n’a pas de fondement. Plutôt que d’afficher une politique de réduction des risques en permettant des approches combinées et des expérimentations en fonction des spécificités des établissements scolaires et des publics accueillis, on a dit qu’il ne se passait rien à l’École en matière de contamination.
Pour ce qui est de l’université, le problème est double : si les étudiants vont très mal, c’est d’une part parce que beaucoup d’entre eux sont éprouvés financièrement, ne pouvant plus exercer les petits boulots qui les faisaient vivre, et d’autre part parce qu’ils se retrouvent souvent éloignés de leur famille dans un endroit qu’ils ne connaissent pas, sans vie sociale du fait de la crise sanitaire. C’est une situation encore plus intenable pour les premières années. Là aussi, ouvrir les facultés implique de limiter les risques. On dispose d’éléments de réflexion établis par des universités américaines, comme recourir à des tests répétés : on connaît la fréquence maintenant et l’arrivée des tests salivaires va simplifier les opérations.
Plutôt que d’afficher une politique de réduction des risques en permettant des approches combinées et des expérimentations en fonction des spécificités des établissements scolaires et des publics accueillis, on a dit qu’il ne se passait rien à l’École en matière de contamination.
 Dès janvier 2020, vous avez été sollicitée dans le cadre de la lutte anti-Covid. Que sait-on de la maladie un an après ?
Dès janvier 2020, vous avez été sollicitée dans le cadre de la lutte anti-Covid. Que sait-on de la maladie un an après ?
Lorsqu’un virus se réplique, et surtout un virus à ARN comme celui de la Covid, des erreurs apparaissent, et donc des variants. Certains deviennent dominants quand ils confèrent un avantage sélectif – l’avantage sélectif étant de contaminer plus de sujets ou de pouvoir infecter des sujets qui ont déjà eu la maladie. Il n’y a pas d’intelligence dudit virus, mais un phénomène purement darwinien.
Il mute moins que la grippe. Il est caractérisé par un très long génome, un des plus longs connus, mais il possède une enzyme de réparation qui lui permet de corriger en partie les erreurs de réplication. Mais il mute malgré tout. Des variants nouveaux, il y en a donc tous les jours mais ceux qui comptent, ce sont ceux qui deviennent dominants.
Il n’y a pas d’intelligence dudit virus, mais un phénomène purement darwinien.
Des traitements ou des vaccins incomplètement efficaces peuvent favoriser l’apparition de mutations. Ce n’est toutefois pas inexorable – et là je pense au VIH -, puisqu’on a maintenant des trithérapies qui ont permis de contrôler la charge virale chez des patients ayant développé des virus résistants aux premières générations de traitement. Malgré tout, une immunité incomplète – par exemple, dans le cas de la vaccination contre la Covid, le renoncement à la deuxième injection – peut produire des situations qui peuvent elles aussi favoriser l’émergence de variants, résistants cette fois au vaccin.
En outre, on sait maintenant que c’est un virus qui peut atteindre beaucoup d’organes, et on n’a pas encore une idée très précise des conséquences à long terme d’une infection, même asymptomatique. Mais on voit apparaître des symptômes ou des atteintes d’organes à distance de la maladie, trois à six mois après la contamination, chez une proportion non négligeable de patients.
on sait maintenant que c’est un virus qui peut atteindre beaucoup d’organes
Ensuite, chez un certain nombre de malades, l’infection a fourni un terrain favorable au 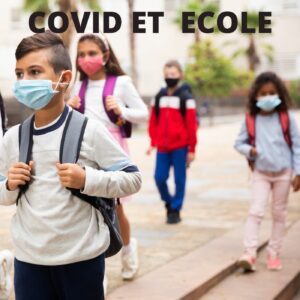 développement d’autres pathologies dont ils continueront à souffrir. Donc, « il ne suffit pas » de compter les morts, il faut aussi prendre en considération l’ensemble des dommages en matière de santé. Croire qu’il suffit de multiplier le nombre de lits en réanimation – ce qui ne serait par ailleurs pas possible logistiquement parce qu’il faut aussi des personnels formés – ne solutionnera pas le problème.
développement d’autres pathologies dont ils continueront à souffrir. Donc, « il ne suffit pas » de compter les morts, il faut aussi prendre en considération l’ensemble des dommages en matière de santé. Croire qu’il suffit de multiplier le nombre de lits en réanimation – ce qui ne serait par ailleurs pas possible logistiquement parce qu’il faut aussi des personnels formés – ne solutionnera pas le problème.
il faut aussi prendre en considération l’ensemble des dommages en matière de santé.
Aussi, je trouve très énervant d’entendre dire qu’on ne soigne pas les gens au prétexte qu’on n’a pas de remède. Bien entendu, les gens ont toujours été traités. Ce qui a changé, c’est la façon de le faire : par exemple, au début, on a assez facilement intubé, avant de s’apercevoir que ce n’était pas une bonne idée et qu’il valait mieux essayer de retarder au maximum ce geste. On a aussi appris qu’il fallait gérer l’anticoagulation pour éviter les problèmes que cela générait et que la dexaméthasone était le seul médicament ayant pour l’instant clairement montré une efficacité manifeste sur la mortalité. Tout cela combiné a quand même permis de réduire la mortalité des personnes hospitalisées de moitié environ. Ce n’est pas spectaculaire, il n’y a pas de médicament miracle, mais comment pouvait-on imaginer en trouver un en si peu de temps !
Vous êtes épidémiologiste et biomathématicienne. Pouvez-vous nous présenter vos travaux ? Nous donner quelques exemples ?
 J’ai fait de la modélisation et j’ai travaillé sur des applications cliniques et de santé publique.
J’ai fait de la modélisation et j’ai travaillé sur des applications cliniques et de santé publique.
En matière de modélisation, la virologue et moi avons montré que la transmission du VIH de la mère à l’enfant était tardive, s’opérant surtout à l’accouchement, et sinon lors du dernier mois de grossesse. Des essais ont montré qu’un traitement administré durant ce dernier mois prévenait la transmission, la réduisant de deux tiers, ce qui a eu des conséquences déterminantes dans les pays à ressources limitées où les femmes sont suivies en fin de grossesse seulement.
Deuxième exemple, au début des traitements du sida, on a constaté que le virus développait des mutations de résistance. J’ai proposé les schémas d’études permettant de surveiller la résistance, en France, chez les patients infectés par le VIH afin d’étudier l’évolution et la fréquence de tel ou tel variant – c’est ce qu’on commence aussi à mettre en place dans le cas de la Covid pour évaluer les proportions de contamination par les différents variants (anglais, d’Afrique du Sud…) – et donc de choisir au mieux le traitement à administrer pour qu’il n’y ait pas de résistance. Avec une autre virologue, , nous avons mis au point une méthodologie permettant de prédire quel traitement allait ou non marcher, donc de prédire quelle allait être la résistance.
Voilà un petit panorama de mes activités, qui portent également des implications de santé publique : ainsi, quand on fait des interventions pour diminuer les infections à VIH (comme par exemple les initiatives des villes sur le sida, que ce soit Nice, Bordeaux, Paris…), on a besoin de produire des indicateurs épidémiologiques pour accompagner et évaluer les mesures prises. • Propos recueillis par Aline Noël pour le magazine du Sgen-CFDT, Profession Éducation, no 278 – Janvier-février 2021.
Née en 1954, Dominique Costagliola est titulaire d’une maîtrise de physique, ingénieure civile de Télécom Paris et docteure en génie biologique et médical. Elle est membre de l’Académie des sciences.
En 1982, elle intègre l’Inserm et est directrice de recherche.
De 2011 à 2019, elle est directrice de l’École doctorale Pierre Louis de santé publique à Paris : Épidémiologie et sciences de l’information biomédicale.
De 2014 à 2019, elle est directrice de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique. Depuis 2018, elle en est directrice adjointe.
Dominique Costagliola est élue Sgen-CFDT Recherche EPST à la commission administrative paritaire de l’Inserm.
Pour en savoir plus sur son parcours : page de présentation de Dominique Castaglio sur le site de l’Inserm.
Crédits photo et illustrations
Dominique Costagliola © Pierre Kitmacher / Sorbonne Université
Images © Pixabay : Elf-Moodance ; mohamed_hassan ; slightly_difference

 Dominique Costagliola en quelques dates
Dominique Costagliola en quelques dates